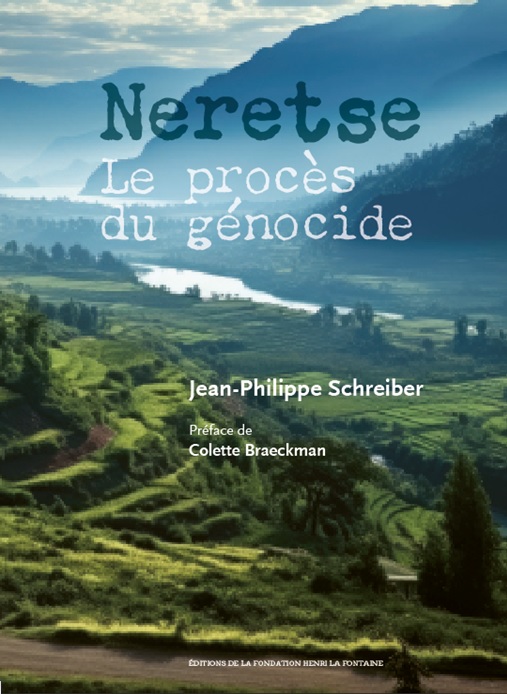
Fin 2019 s’est tenu à Bruxelles le premier procès pour crime de génocide. Le prévenu s’appelait Fabien Neretse, inculpé pour sa participation à l’extermination des Tutsi au Rwanda en 1994.
Jean-Philippe Schreiber raconte ici ce procès et en tire une réflexion sur le génocide, sa nature, son exécution et ses exécutants, sa falsification ou sa mémoire, réinsérant l’événement dans l’histoire des crimes de masse au XXe siècle.
Neretse. Le Procès du génocide est un livre d’histoire : des comportements coloniaux aux événements de 1994, en n’omettant pas de mettre en évidence les comportements et décisions prises par, notamment, les colonisateurs. C’est aussi un témoignage brûlant, raconté à la première personne, de ce que l’auteur a vu tant au Rwanda même en 1995 que lors des audiences du procès auquel il assista. C’est également une très forte réflexion sur le concept même de génocide : qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que ce n’est pas ? Une question qui renvoie inévitablement aux autres génocides du XXe siècle : la Shoah et le génocide des Arméniens.
Enfin, l’auteur décortique l’après génocide lorsque des intellectuels, des politiques ont tenté de réécrire l’histoire allant jusqu’à propager des thèses négationnistes. Une autre constante lors des crimes contre l’Humanité.
Extrait
Un procès est un théâtre, avec ses acteurs, son décor, sa dramaturgie. Avant le début de l’audience, il y a l’attente de la Cour, et son arrivée – imprévisible. Dans l’intervalle, on chuchote, on se salue, les avocats daignent descendre dans le prétoire, discutent avec le public ; les proches des victimes sont présentes, avec constance, chaque jour. Le magistrat fédéral, en robe rouge, est affairé au téléphone, tourne autour de son siège, parle beaucoup, se gratte les tempes. La salle bruit de rumeurs – des membres de l’Akazu, le premier cercle de la famille de l’ex-président Juvénal Habyarimana, seraient présents au procès, me souffle-t-on.
L’audience a du retard, les élèves qui viennent y assister pour découvrir comment la Justice se rend remplissent la salle, mais ne sont pas les plus bruyants – la solennité des lieux les impressionne, assurément. Certains jours, des policiers nous entourent en nombre, d’autres pas, allez savoir pourquoi… Aujourd’hui, un policier armé me fait directement face durant l’ensemble des débats : sa présence rappelle que non seulement l’exercice de la Justice doit être protégé, mais que ce qui concerne le génocide des Tutsi continue de générer des menaces, des intimidations, des provocations voire des agressions.
Martine Beckers, la sœur de l’une des victimes du prévenu, est déjà au premier rang, prête à suivre les débats avec attention et émotion, présente à chaque session de la Cour, attentive, prenant des notes, comme elle l’a déjà fait lorsqu’elle fut partie civile au procès de 2009 ; elle dessine souvent durant les audiences, esquissant depuis les bancs du public le portrait des protagonistes. Enfin, les jurés arrivent, signe que le greffier va bientôt annoncer le début de l’audience. Les avocats sont en place depuis longtemps lorsque la présidente de la Cour d’Assises, Sophie Leclercq, vient ouvrir les débats. La sonnette retentit. La présidente entre, entourée de ses assesseurs. L’audience peut reprendre.
Le procès de Fabien Neretse, qui s’ouvre ce 4 novembre 2019, a lieu en même temps que la présidente birmane défend laborieusement son armée devant la Cour internationale de Justice à La Haye. Il aurait pu comme aux Pays-Bas se dérouler dans une de ces salles d’audience aseptisées, modernes, au design scandinave, et peut-être, de ce fait, être un peu moins chargé de symboles. Non, tout au contraire, il se déroule dans une salle vieillie et sépulcrale du Palais de Justice de Bruxelles, en ce lieu tellement hors du temps, témoin d’une splendeur passée où la Belgique au faîte de sa gloire coloniale se pensait le centre du monde et entendait diffuser partout sa conception de la liberté et du progrès, de la morale et de la religion, jusqu’au cœur de l’Afrique.
Aujourd’hui, l’immense Palais de vingt-six mille mètres carrés conçu par Joseph Poulaert et construit au mitan du règne de Léopold II, entre 1866 et 1883, ploie depuis des décennies sous des échafaudages qui le soutiennent, tel un monstre chancelant. Il paraît un navire blessé n’ayant pu échapper au temps qui a passé et transformé le monde, malgré lui. Le procès Neretse se joue dans ce théâtre compassé, dans une salle d’audience agencée comme un temple au décor d’égyptomanie et d’allégories de la Justice, qui n’a pas changé sans doute depuis l’époque où le Rwanda était encore sous la férule coloniale belge. Comme s’il renvoyait non seulement au dernier génocide du XXe siècle, mais également à l’idéologie raciale que le colonisateur a imposée au centre de l’Afrique, et qui a servi le projet génocidaire.